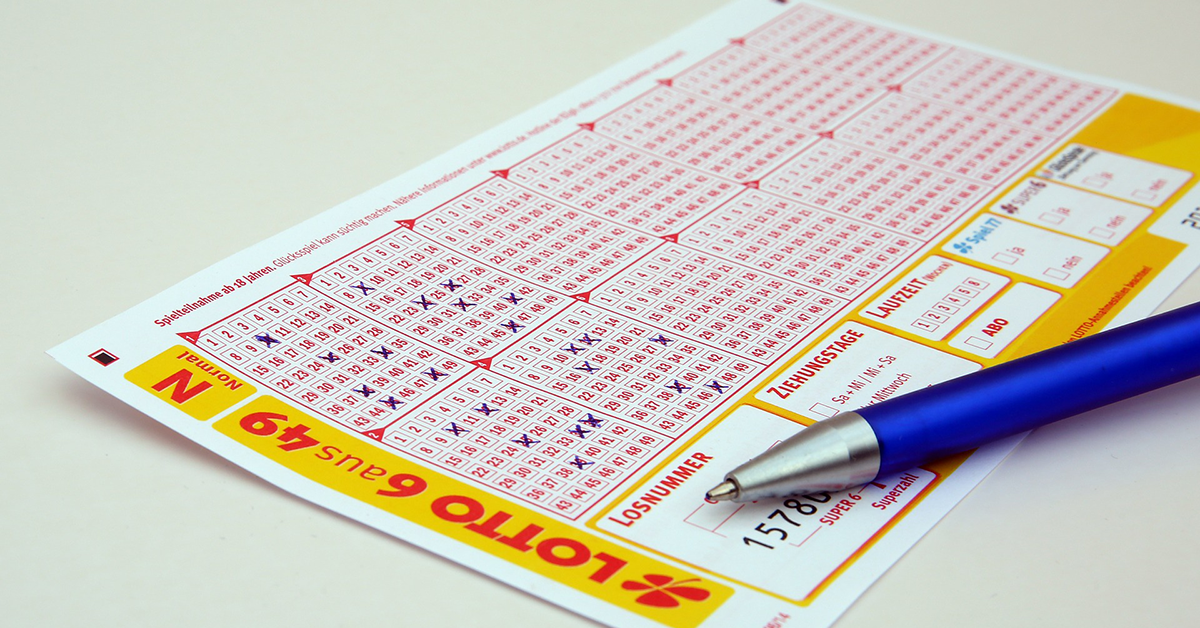
Il se déduit des paragraphes 462.37(3) et (4) du Code criminel que lorsque l’objet ou le produit de l’infraction est insusceptible de confiscation , le tribunal doit condamner le contrevenant à payer une amende en lieu et place de la peine complémentaire de confiscation1, en l’assortissant d’une peine d’emprisonnement en prévision d’un défaut de règlement. Le prononcé de cette peine automatique revient ainsi à fixer un minimum incompressible d’incarcération de plein droit qui s’impose au juge en fonction du montant de l’amende infligée, ainsi que l’exige l’alinéa 462.37(4)a). Or cette automaticité n’est pas sans réveiller plusieurs craintes par rapport à la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés de ces dispositions. Le jugement de rejet du 5 novembre 2018 de la Cour supérieure de justice de l’Ontario livre son interprétation du quantum minimum énoncé au sous-alinéa 462.37(4)a)(vii), qui a fait l’objet d’une question de constitutionnalité au regard des articles 7 et 12 de la Charte.
- R. v. Chung, 2018 ONSC 6633, 2018 CarswellOnt 18390
La cupidité n’a aucune limite, l’arnaque non plus, a priori. La singularité du présent dossier découle de la dimension de la fraude commise, mais aussi du rôle moteur joué par le père des accusés à travers les validations successives de billets de loto, dont ils n’étaient pas les vrais gagnants présumés. Le 9 avril 2018, des membres d’une même famille sont reconnus coupables2d’infractions de « fraude », « vol » et « possession de biens criminellement obtenus » sur le fondement des paragraphes 380(1) et 322(1) ainsi que des alinéas 334a) et b) et 354(1)a) C.Cr.. Le montant du casse, dans cette affaire, est vertigineux. On évoque le chiffre de 12,5 M$ obtenus frauduleusement auprès de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (SLJO). À côté, les quelques dizaines de milliers de dollars empochés indûment par les accusés font nettement pâle figure. Après avoir obtenu leur condamnation à des peines principales d’emprisonnement en septembre dernier, le ministère public saisit le juge d’une requête tendant à faire restituer et confisquer aussi bien l’objet que le produit des infractions, y compris, à défaut, une somme en tenant lieu. Sa demande se heurte néanmoins à l’impossibilité matérielle de recourir à l’une de ces mesures à l’encontre de deux d’entre eux, faute du caractère confiscable des biens acquis et du pactole frauduleusement obtenu par ces derniers. Pour pallier cette difficulté, le poursuivant requiert alors qu’ils soient condamnés au paiement d’une amende égale à la valeur de l’objet des infractions conformément aux prescriptions du paragraphe 462.37(3) C.cr.
À cette occasion, les accusés ont soulevé une question de constitutionnalité portant sur le sous-alinéa 462.37(4)a)(vii), formulée en ces termes : « les dispositions contestées, en ce qu’elles prévoient l’application automatique d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à la peine minimale de cinq ans en cas de défaut de paiement de l’amende encourue, portent atteinte aux principes de justice fondamentale résultant de l’article 7 ainsi qu’aux exigences de proportionnalité procédant de l’article 12 de la Charte ». La jurisprudence de la Cour suprême du Canada relative aux peines minimales obligatoires3 a nécessairement inspiré les accusés. De longue date, la Cour suprême juge opportunément que ces peines d’emprisonnement, en ce qu’elles interdisent au juge d’écarter le seuil minimal fixé en amont par le législateur, peuvent dans certaines circonstances être entachées d’inconstitutionnalité au vu des articles 1er et 12 de la Charte. C’est donc sans surprise réelle que les accusés ont espéré pouvoir s’appuyer sur cette jurisprudence pour remettre en cause la peine minimale prononcée à leur égard.
Toujours est-il, selon la plus haute juridiction canadienne, qu’au moment de la prononciation de la peine d’amende, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour jauger les ressources et les charges du contrevenant4. Les intéressés ont fait observer que cette jurisprudence a vocation à s’appliquer, alors même que le contrevenant ne dispose pas de fonds suffisants. Or, selon eux, le simple fait qu’une peine minimale d’emprisonnement puisse être prononcée ab initio en prévision d’un éventuel défaut de paiement de l’amende est symptomatique de l’existence d’un trou dans la raquette du sous-alinéa 462.37(4)a)(vii), dans la mesure où la valeur des biens, objet de l’amende, pourrait être considérablement réduite pendant le délai de paiement initialement fixé par le juge. Si le premier argument visait a priori le caractère disproportionné de la peine minimale d’emprisonnement, le second n’aspirait qu’à voir le montant de l’amende diminué. Enfin ont-ils avancé, de façon plus étonnante, que le prononcé de la peine minimale obligatoire n’est justifié qu’à condition que le juge ait préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement, de sorte qu’ils puissent être à même de contester cette peine. Autrement dit, à en croire ce dernier moyen invoqué en vertu de l’article 7 de la Charte, il s’agit d’asseoir les principes de justice fondamentale sur le droit pour tout accusé de présenter ses propres observations et de participer réellement à l’audience de fixation de sa peine.
Sur le premier point, le juge relève, d’une part, qu’en instaurant des peines d’amende et d’emprisonnement aux paragraphes 462.37(3) et (4), le législateur a entendu renforcer l’exigence de restitution des biens mal acquis tout en assouplissant le verrou à l’égard du délinquant et que, compte tenu de cette finalité, ni la peine d’amende ni la peine minimale obligatoire n’ont le caractère de punition. Si, aux premiers abords, cette lecture paraît surprenante, en réalité, il n’en est rien. En effet, restitution et condamnation ne sauraient se confondre. La détermination de la peine prend en compte d’autres éléments d’appréciation que la restitution et la confiscation de l’objet ou du produit de l’infraction. Du point de vue de la logique légaliste, donc, l’amende et la peine minimale de substitution ne peuvent être qualifiées en tant que telles de peines, mais de modalités d’exécution d’une mesure de restitution. Aussi faut-il concéder que le montant de l’amende encourue est avant tout proportionnel avec l’objet et le produit des infractions et que, par conséquent, un système de justice pénale qui consentirait à ce que la personne condamnée puisse s’enrichir en conservant le bénéfice des infractions pour lesquelles elle a été condamnée serait, dans les faits, privé d’une véritable portée dissuasive. D’autre part, que le tribunal n’est pas dénué de rôle pendant le cours du délai de paiement initial, puisque les paragraphes 462.37(3) et (4) ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales du Code criminel qu’autant qu’ils leur sont contraires. Par exemple, le tribunal tire de l’article 734.3 la faculté de modifier l’une des conditions d’application ou de mise en oeuvre de son ordonnance afin de tenir compte de tout paiement, fût-il complet ou partiel, voire, sur le fondement du paragraphe 734.8(1), d’en moduler la durée de fond en comble à la hausse ou à la baisse. Ainsi, à s’en tenir à cet article, l’ordonnance judiciaire ne fixera pas irrévocablement des dispositions qui ne pourront plus être sujettes à modification. Le législateur n’ayant pas fixé de maximum ni de minimum à cet égard, rien ne fait obstacle à ce que le délai de paiement soit allongé, ou encore à ce qu’un paiement soit imputé proportionnellement sur le montant de l’amende.
Le juge était donc à ce titre attentif, d’une part, au lien entre la peine d’amende obligatoire et la nécessité d’assurer une meilleure restitution des fonds frauduleusement obtenus et d’autre part, aux possibilités de modulation de l’ordonnance prévue par le paragraphe contesté. Il a, au surplus, évoqué que si la peine minimale d’emprisonnement doit être exécutée sitôt que le délai de paiement de l’amende arrive à échéance, le paragraphe 734.7(1) subordonne l’émission d’un mandat d’incarcération à la condition que le contrevenant refuser, sans excuse raisonnable, de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736. L’interprétation stricte par le juge de cette disposition s’explique aussi par les effets énergiques qu’il attache au défaut de paiement, celui-ci prenant le soin d’y associer le postulat posé par la Cour suprême du Canada, selon lequel le « défaut de paiement » vaut « excuse de paiement »5. Si bien que le juriste ne sera pas décontenancé en observant que l’incapacité financière peut parfois constituer un artifice pour masquer, à travers une cession gratuite ou une évasion fiscale, la volonté de ne pas payer. Enfin, au-delà de ces indications, le juge ajoute sans ambages que tant les alinéas 735.4(a) et (b) que le paragraphe 734.6(1) permettent à la Couronne, pour le recouvrement de créances impayées, de solliciter des sanctions administratives et des réparations civiles à l’encontre des intéressés.
À dire vrai, il n’est pas de précédent par lequel la Cour d’appel de l’Ontario aurait invalidé un tel dispositif pour les peines minimales d’emprisonnement qui doivent être exécutées à défaut de paiement de l’amende encourue6. Le juge s’est, toutefois, échiné à expliquer en l’espèce que dans la mesure où la peine d’emprisonnement prononcée, et non encore encourue, peut aller jusqu’à 10 ans, voire 24 ans, des demandes de modification, y compris de modulation de la durée, de l’ordonnance peuvent davantage retarder l’exécution de la peine minimale. Pour cause, dans l’hypothèse inverse, la solution aurait pu être discutable si le juge ne disposait que d’un pouvoir d’individualisation restreint et qu’il ne pouvait pas, par exemple, moduler la durée de son ordonnance. Ne serait-ce qu’avec les outils mis à la disposition du juge, effectivement, plusieurs dispositions du Code permettent d’aplanir les difficultés liées à l’application automatique de la peine minimale d’emprisonnement. Force est donc de constater que le bénéfice de certains aménagements n’a pas été expressément exclu par le législateur. Ces éléments relativisaient fortement la critique des accusés selon laquelle le juge ne peut pas faire varier le quantum minimum préétabli par le législateur, ainsi que le parallèle dressé entre la peine d’emprisonnement automatique et l’amende encourue. À l’analyse, on n’y voit concrètement rien à redire, si ce n’est que l’idée d’un traitement cruel et inusité (sic) des intéressés, au sens où l’entend l’article 12 de la Charte, semblait en l’occurrence largement hypothétique. Il est, en effet, difficile d’affirmer que le paragraphe 462.37(4) est pourvu d’un mécanisme contraignant ou que l’application automatique de la peine minimale à défaut de paiement de l’amende prendra effet sans qu’un acte opérant prorogation du délai de paiement, équivalent à la demande en justice, intervienne.
Sur le second point, le juge, auquel il était demandé d’examiner les paragraphes instituant les peines d’amende et d’emprisonnement obligatoires au regard des principes de justice fondamentale, a écarté ce grief du périmètre de l’article 7 de la Charte. Il a, à raison, considéré qu’aucune disposition légale ni exigence procédurale ne fait échec à la possibilité d’exercer le droit de présenter des observations orales ou écrites à tous les stades de la procédure et que, par conséquent, les principes de justice naturelle n’étaient pas enfreints. On sait déjà l’importance qu’accordent les juges au respect des droits de la défense. Le moyen soulevé par les accusés en vertu de l’article 7 était en l’espèce tellement superfétatoire qu’il intéressait plus le champ d’application du droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière que celui des principes de justice fondamentale. Autrement dit que sa pertinence laissait à désirer concernant l’examen de la question de constitutionnalité des peines minimales.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi relevés, on comprend donc que le juge avait toute latitude pour estimer qu’eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en oeuvre de cette peine minimale, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l’objectif de restitution des biens mal acquis et les modalités d’exécution des mesures prévues à cette fin. Plus encore, en cas de demande présentée aux fins d’allongement du délai de paiement de l’amende, il sera possible à notre sens de se référer à des éléments dont il était impossible de tenir compte à la date du prononcé de l’ordonnance initiale, à savoir les ressources et les charges des accusés. En somme, la solution retenue en l’espèce, pour conforme qu’elle soit à l’esprit de la loi, n’a donc, en soi, rien de surprenant, tant elle paraît s’inscrire dans les discussions qui ont eu lieu dernièrement au Parlement à l’occasion de l’examen du projet de loi C-75.
1 Les conditions faisant obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure de confiscation sont précisées aux alinéas 462.37(3)a), b), c), d) et e) C.cr.
2 R. v. Chung, 2018 ONSC 2177.
3 R. v. Llyod, [2016] 1 R.C.S. 165; R. v. Nur, 2015 CSC 15; R. c. Pham, 2013 CSC 15; R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6.
4 R. v. Lavigne, 2006 C.S.C. 10, [2006] 1 R.C.S. 393.
5 R. v. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530.
6 R. v. Le (2006), 161 C.R.R. (2d) 365 (C.A. Ont.)