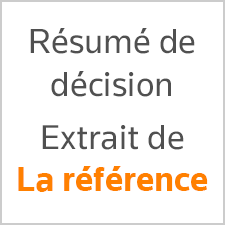
Les juges Bich et Doyon. La Commission des normes du travail se pourvoit à l'encontre du jugement qui a rejeté l'action qu'elle avait intentée contre l'entreprise intimée, IEC Holden inc. (ci-après: l'employeur), afin de lui réclamer, pour le compte de salariés licenciés en 2009, les indemnités qui auraient dû être payées auxdits salariés en vertu des articles 82 et 83 (avis de cessation d'emploi) et 84.0.1 et 84.0.13 (avis de licenciement collectif) de la Loi sur les normes du travail (LNT). La Commission plaide que le juge de première instance a commis une erreur en acceptant la prétention de l'employeur qu'il n'était pas visé par ces dispositions. C'est que ce dernier a plaidé que les salariés en cause étaient liés à lui par des contrats de travail à durée déterminée qui n'ont simplement pas été renouvelés à leur terme — et qui ont donc expiré — , situation que le législateur a soustraite expressément des obligations prévues par les articles 82 et 83, d'une part, et 84.0.1 et 84.0.13, d'autre part. Le législateur énonce en effet, aux deuxièmes paragraphes des articles 82.1 et 84.0.2, que les articles 82 et 84.0.1 ne s'appliquent pas à l'égard d'un salarié «dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire». La Commission reprend devant la présente Cour l'argumentaire présenté devant la Cour supérieure, à savoir que les contrats en cause n'étaient à durée déterminée qu'en apparence et qu'il s'agissait en réalité de contrats à durée indéterminée.
L'employeur n'a pas tort d'affirmer la légitimité du contrat de travail à durée déterminée, institution juridique reconnue, que le Code civil du Québec consacre en termes on ne peut plus explicites à son article 2086, tout comme, du reste, la Loi sur les normes du travail. Ainsi, il est vrai de dire qu'un employeur et un salarié peuvent décider de conclure un tel contrat et qu'on ne saurait leur en faire reproche, pas plus qu'on ne saurait tenter d'invalider ou de transformer ce choix contractuel. Précisons que le fait que l'usage de ce type de contrat contribue à la précarisation de l'emploi ne justifie pas, en soi, de condamner cet usage. Aussi, peu importe les raisons qui peuvent amener les parties à conclure un tel contrat, lorsque celui-ci est clair et qu'un terme y est stipulé sans équivoque, il y a lieu d'y donner effet.
L'employeur a raison également de soutenir qu'il ne faut pas confondre le concept de contrat à durée indéterminée avec la notion de «service continu», que le paragraphe 12 du premier alinéa de l'article 1 LNT définit et qui sert de base à certaines normes et à certains recours. Comme on le voit à la lecture de ce paragraphe, le législateur calcule le service continu sans égard à la nature du contrat. Ce qui compte, c'est la durée de la période pendant laquelle le salarié est, sans interruption, lié à l'employeur, que ce soit en vertu d'un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou même en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée. Il s'ensuit qu'il est vrai d'affirmer que le législateur, implicitement, reconnaît que des contrats à durée déterminée peuvent se suivre sans interruption sans que cela les transforme en un contrat à durée indéterminée. D'ailleurs, le législateur, dans les sections de la LNT portant sur les avis de cessation d'emploi et de licenciement collectif, accorde explicitement un traitement distinct au contrat à durée déterminée et au contrat à durée indéterminée. Cela dit, comme le montre la jurisprudence, il n'est pas toujours facile, dans les faits, de distinguer ces deux types de contrats. Parfois, les termes utilisés dans le contrat sont ambigus, contradictoires ou incompatibles. D'autres fois, c'est plutôt le comportement des parties, jumelé au texte de leur entente, qui engendre une situation équivoque. L'article 2090 C.c.Q. clarifie justement l'une de ces équivoques en prévoyant expressément que le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l'arrivée du terme, le salarié continue d'effectuer son travail durant cinq jours, sans opposition de la part de l'employeur. Ajoutons encore que, même si une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ne fait pas, en elle-même, un contrat à durée indéterminée, il n'est pas exclu que, dans certains cas, une telle succession indique soit la véritable nature de la relation contractuelle, c'est-à-dire une relation à durée indéterminée, soit la transformation du rapport d'emploi en un rapport à durée indéterminée ponctué de moments où les parties font le point sur leur relation tout en convenant de la poursuivre. Dans ces cas, le renouvellement répété du contrat devient parfois une simple mécanique qui ne traduit pas — ou ne traduit plus — la volonté réelle des parties, dont la relation s'inscrit dans une durée en réalité indéterminée, c'est-à-dire dans une certaine forme de permanence. Or, selon la Commission, c'est exactement la situation qui existe ici.
Qu'elle était, en l'espèce, l'intention des parties? La preuve administrée de part et d'autre comporte des éléments contradictoires, certes. Cependant, de l'avis de la Cour, cette preuve établit néanmoins de manière prépondérante que l'employeur et chacun de ses salariés étaient engagés dans un contrat à durée indéterminée, résultant d'une succession d'écrits ayant la forme de contrats à durée déterminée. Il est vrai que les exemples types de contrats que fait signer l'employeur à ses salariés comportent tous la mention d'un terme précis et qu'ils commencent tous par une phrase destinée à mettre en lumière la relation entre la durée du contrat et celle des activités de l'entreprise. C'est que l'employeur affirme faire coïncider la durée et l'époque des contrats avec les bons de commande qu'il reçoit tout au long de l'année et qui, selon ses dires, dicteraient à tout moment ses besoins de main-d'oeuvre. L'employeur explique en effet qu'il exploite une entreprise oeuvrant exclusivement en sous-traitance pour quelques clientes, dont une lui fournit 80 % de ses commandes. En somme, il dépend entièrement de ses clientes, lesquelles lui confient le surplus de travail qu'elles ne sont pas en mesure de faire effectuer par leurs propres salariés. Les activités de l'employeur connaissent donc des hauts et des bas, ce qui l'oblige à en assurer la gestion selon le modèle du «juste à temps». C'est dans ce contexte qu'il embauche ses salariés pour de courtes périodes à la fois seulement; il fait signer à chacun d'eux un contrat de travail dont la durée correspond aussi exactement que possible aux commandes qui lui sont confiées par ses clientes. Si, au terme d'un contrat de travail, il a encore besoin du salarié parce qu'un nouveau contrat lui a été confié par une cliente, il fait alors signer au salarié un autre contrat d'une durée qui varie selon la commande passée par la cliente. C'est, en tout cas, ce qui ressort du témoignage de M. Aubry. Cependant, le témoignage de M. Herrick, qui a occupé le poste de «project manager» et de vendeur chez l'employeur pendant plus d'une année, contextualise les explications de M. Aubry. On comprend en effet du témoignage de M. Herrick qu'il existe des arrangements à plus long terme entre l'employeur et ses clientes (ou, du moins, sa cliente principale), ce qui est tout à fait compatible avec la nécessaire mobilisation des moyens techniques et humains requis afin de remplir chaque commande, compte tenu de la nature des biens produits (des moteurs de locomotives). C'est donc dans le cadre de ces arrangements que l'employeur procède à l'affectation périodique des salariés à une commande ou à une autre. Et c'est bien cela que l'on observe, en réalité, et non pas le processus d'embauches-surprises, non planifiées, «au feeling», que semble décrire M. Aubry. Ces affectations périodiques, elles-mêmes à durée déterminée, n'excluent cependant aucunement que le contrat de travail entre l'employeur et ses salariés soit à durée indéterminée.
D'autres éléments doivent également être considérés, que n'analyse pas le jugement attaqué. Ainsi que le souligne le juge de première instance, on ne peut pas ignorer que les salariés sont conscients des mentions qui figurent sur les documents qu'ils signent. Par contre, il faut aussi tenir compte du fait qu'on recrute les salariés sans leur préciser qu'ils seront embauchés pour une durée déterminée. En effet, la preuve démontre que ce n'est qu'une fois leur période de formation et d'essai terminée qu'on fait signer aux salariés les documents mis en preuve. Il faut aussi tenir compte du fait que, pour les salariés, la signature périodique et répétée de «nouveaux contrats», à chaque échéance, relève de la simple formalité administrative et n'altère pas leur intention de s'engager avec l'employeur dans une relation continue et sans terme extinctif particulier. C'est ce qui ressort clairement de la preuve. De même, il ressort tout aussi clairement de la preuve que les salariés s'attendent à être maintenus au travail et que l'employeur, de son côté, s'attend à ce qu'ils y demeurent, contrat après contrat. Or, de telles attentes vont au-delà de la simple expectative, de part et d'autre; elles confirment plutôt l'intention de chacun des contractants d'accepter un engagement à durée indéterminée. De plus, il faut constater que l'employeur, dans les documents qu'il fait signer aux salariés, se réserve généralement la possibilité de procéder à des mises à pied. Or, l'idée d'une mise à pied, et même simplement d'une réserve de ce genre, dans un contrat à durée déterminée est tout aussi incompatible avec la nature de ce contrat et les principes qui le régissent que l'est l'inclusion d'une clause de résiliation unilatérale sans cause, avec ou sans préavis. Elle est plutôt tout à fait conséquente avec l'idée d'affectations à durée déterminée s'inscrivant dans le cadre d'une relation contractuelle à durée par ailleurs indéterminée. La Cour note également qu'un certain nombre des contrats ont été signés plus de cinq jours après la date d'expiration du contrat précédent, alors que les salariés en cause ont continué sans interruption d'être au travail. Dans d'autres cas, on observe que la lettre offrant le «nouveau contrat» porte une date postérieure à celle où le salarié a effectivement commencé à travailler. On peut certainement voir dans ces situations des cas d'application de l'article 2090 C.c.Q., précité, c'est-à-dire la manifestation du caractère purement administratif de la formalité de signature du contrat. En tous cas, elles tendent à démontrer que les parties sont sûres l'une de l'autre et sûres de poursuivre leur relation. Tous ces éléments convergent et, pour la Cour, un constat prépondérant se dégage de l'ensemble du portrait, à savoir que l'employeur et ses salariés sont liés par un contrat qui, en réalité, a tout, dans sa substance, du contrat à durée indéterminée, et ce, même si on a tenté de lui donner la forme d'un contrat à durée déterminée. Malgré l'indication d'un terme dans les contrats, rien ne démontre chez l'employeur une volonté de garder une liberté complète de contracter avec d'autres que les salariés qui sont à son service, qu'il a formés, puis embauchés après une période d'essai, et qu'il garde de facto à son service dans certains cas depuis quatre ou cinq ans. On ne détecte pas non plus de pareille volonté chez les salariés, qui manifestent leur intention de demeurer continûment au service de l'employeur. En somme, ce que la preuve révèle c'est une mécanique qui ne traduit pas la volonté réelle des parties de se lier pour une durée déterminée, mais plutôt celle d'entretenir une relation contractuelle s'inscrivant dans une durée indéterminée. Ce faisant, la soussignée n'affirme pas que la succession de contrats à durée déterminée équivaut toujours, purement et simplement, à un contrat à durée indéterminée, mais qu'elle peut attester l'existence d'un contrat à durée indéterminée ou la transformation de la relation d'emploi en une relation à durée indéterminée et que, dans les circonstances du présent dossier, c'est précisément ce que la preuve démontre.
Par conséquent, la Cour conclut que les exclusions prévues par les paragraphes 2 des articles 82.1 et 84.0.2 LNT ne sont pas applicables en l'espèce, et que c'est donc le régime ordinaire des articles 82 et 83 et 84.0.4 et 84.0.13 qui s'applique. Les salariés visés ont droit aussi à leur indemnité de congé annuel, en vertu de l'article 74. De façon subsidiaire, l'employeur demande que soit déduit des indemnités tenant lieu de préavis un montant égal au salaire versé en exécution des derniers «contrats» signés par les salariés, comme si ces contrats constituaient des avis «travaillés». Cette demande doit être rejetée, car les salariés n'avaient pas été informés qu'ils seraient licenciés au terme de cette dernière affectation, que l'on ne peut pas assimiler à un préavis dont ils auraient eu le bénéfice et dont l'équivalent monétaire devrait maintenant être soustrait des sommes réclamées pour leur compte par la Commission. Il y a donc lieu de faire droit à la réclamation de la Commission pour l'intégralité des sommes dus aux 29 salariés visés par l'action. Le montant total accordé est de 102 989,85 $.
La Cour estime qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de la Commission de lui accorder le montant forfaitaire prévu par le premier alinéa de l'article 114 LNT. Il ressort de la jurisprudence que l'attribution de ce montant est discrétionnaire, qu'il ne s'agit pas d'une pénalité, mais plutôt d'une mesure de financement de la Commission, et qu'on tend à ne pas l'accorder lorsque l'employeur est de bonne foi et qu'il a défendu un point de vue qui, pour être erroné, n'en était pas pour autant déraisonnable. En l'espèce, on ne peut pas dire que le débat était déraisonnable, puisque la question en jeu en était une de principe qui a donné à la Cour d'appel l'occasion de clarifier le droit (puisque le très récent arrêt Atwater Badminton and Squash Club Inc. c. Morgan n'avait pas encore été prononcé au moment où les salariés visés par la présente réclamation ont été licenciés, ni même au moment où le présent pourvoi a été entendu). De plus, la preuve ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur et la bonne foi d'une partie se présume, selon l'article 2805 C.c.Q.
La Cour est donc d'avis d'accueillir le pourvoi pour partie. Le jugement de première instance est annulé, sauf quant à la conclusion contenue à son paragraphe 37, dans lequel le tribunal prend acte de l'engagement de l'employeur de payer à la Commission, pour le compte du salarié Herrick, la somme de 5 520 $. L'employeur est condamné à payer la somme de 102 989,85 $ à la Commission, pour le compte des salariés visés.
Le juge Hilton. L'analyse convaincante de l'ensemble de la preuve a amené la juge Bich à conclure que la véritable intention des parties, malgré le texte des contrats de travail litigieux, était d'établir une relation contractuelle à durée indéterminée, une analyse à laquelle le juge de première instance ne s'était pas livré. Ce faisant, la juge Bich a simplement suivi les enseignements de la Cour d'appel, ce qui suffit pour fonder une intervention de la part de cette cour. Le soussigné partage aussi l'avis de la juge Bich que la Commission n'a pas droit à l'octroi du montant prévu par le premier alinéa de l'article 114 LNT. Il ajoute même que, non seulement la Commission n'a pas établi la mauvaise foi de l'employeur, mais que, au surplus, la preuve a démontré sa bonne foi, indépendamment de la présomption établie par l'article 2805 C.c.Q. Le texte de l'article 2086 C.c.Q., lu avec les articles 82.1.2o et 84.0.2.2 LNT, laisserait certainement croire à un employeur que les renouvellements ici en litige n'auraient pu donner lieu à une condamnation dans le cas des non-renouvellements comme si ceux-ci constituaient un licenciement collectif prévu à l'article 84.0.1. D'abord, rien dans la preuve ne suggère que l'employeur a conçu ce type de relation contractuelle pour une raison autre que des considérations commerciales légitimes, et encore moins peut-on prétendre qu'il l'a fait dans le but de contourner la Loi. En fait, l'employeur, comme n'importe quel autre employeur, aurait pu penser raisonnablement, et donc de bonne foi, que le texte de ces dispositions est clair et ne nécessite que leur application. À cela s'ajoute le fait que l'employeur avait offert aux salariés concernés des avantages accessoires assez généreux, indépendamment de ses obligations statutaires, ce qui est tout à fait compatible avec un employeur agissant de bonne foi à l'égard de ses salariés.
Le soussigné tient toutefois à préciser qu'il craint que les motifs que la juge Bich donne aux paragraphes 50 à 54 de sa décision, malgré les réserves qu'elle y exprime, ferment effectivement la porte au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée, sans courir pour autant un risque très élevé de voir ceux-ci interprétés comme étant des contrats à durée indéterminée. Pour le soussigné, le message de la juge Bich est assez clair et sans équivoque: le renouvellement des contrats à durée déterminée est à éviter et l'employeur qui essaie de plaider qu'il n'y a pas «un automatisme ou une conclusion obligée», sera heurtera néanmoins à un fardeau de preuve presque insurmontable afin d'établir que les contrats litigieux ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Cela dit, le soussigné reconnaît que le présent pourvoi doit effectivement être accueilli en partie, vu les faits particuliers mis en preuve.

Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.
Ouvrir une session | Demander un essai gratuit